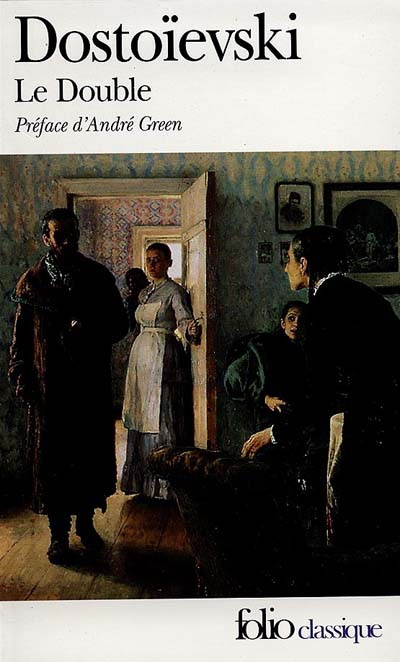Mon boulot d’en ce moment consiste à arpenter les exploitations agricoles pour faire du recueil de données chiffrées à visée statistique. Je vais donc de ferme en ferme, je pose des questions à base d’hectares, de tracteurs, de labour et de gestion des déchets et c’est super-rigolo. Pas tant les hectares, les tracteurs et le reste, mais ce qu’il y a autour. Parce que dans les fermes, les gens aiment bien causer, et c’est chouette parce que moi j’aime bien écouter. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré Yvette*. Et Yvette, à elle toute seule, va faire chuter toutes les moyennes des statistiques nationales.
J’avais donc pris rendez-vous avec Yvette par téléphone. Et elle m’avait déjà expliqué qu’elle a 88 ans. Rien qu’avec ça, elle va tout dérégler les moyennes. J’arrive donc, non sans peine, devant sa petite maison – il a quand même fallu que je passe par un chemin forestier au milieu duquel j’ai dû m’arrêter pour enlever une grosse branche de la route, puis que je m’arrête encore dans un hameau pour demander mon chemin parce que le GPS avait renoncé à trouver la maison d’Yvette. Je frappe à la porte et j’entends une voix claire annoncer :
« C’est ouvert, entre donc ! »
Yvette ne m’a même pas encore vue qu’elle me tutoie déjà. L’embêtant, c’est que je vais être obligée de la vouvoyer : je sais que ça ne se fait pas du tout, par ici, de vouvoyer les gens, même âgés, mais le contexte professionnel a tendance, lui, à ne pas trop connaître les règles locales. J’entre donc dans une toute petite pièce où il fait environ 32°C. Un énorme poêle à bois ronronne, et la fenêtre entrouverte ne change pas grand-chose à la surchauffe. Sur la table, il y a deux bols, de la confiture, du beurre, du sucre et des crêpes sont gardées au chaud sur le poêle. Et assise à table, il y a donc Yvette, qui a l’air dix ans plus jeune qu’elle ne l’est. Que je vienne pour des questions administratives et qu’on ne me connaisse pas dans cette maison n’y changera rien : j’aurais l’obligation d’avaler deux crêpes tartinées de confiture et deux grands bols de café.
J’aurais pu remplir le questionnaire en cinq minutes : ça aurait été très impoli dans ce contexte. Yvette n’a que quelques vaches qu’elle élève pour avoir un complément de revenu. Elle a aussi un vieux tracteur. « De 1954 ». Non seulement il lui suffit, mais elle ne comprend absolument pas « pourquoi les jeunes de maintenant dépensent des fortunes dans ces gros engins ». Et puis très vite, Yvette a débordé des questions d’hectares, de tracteurs, de labour et de gestion des déchets. Des déchets, elle n’en produit pas : ses vaches ne mangent que de l’herbe. Et du labour, elle n’en fait pas : elle n’a que des pâtures. Voilà, le questionnaire était rempli. Mais Yvette n’avait pas fini de raconter.
Quand Yvette a repris la ferme de ses parents, elle avait douze vaches. Des pies noirs, race presque disparue maintenant, remplacée « par des grosses vaches qui font du lait qui manque de gras et qui ne tiennent pas sur leurs pattes ». Elle faisait toute la traite à la main. Le laitier ne venait pas jusque la ferme parce qu’il fallait traverser la rivière et qu’à l’époque, il n’y avait pas de pont. Tous les matins, elle descendait donc les bidons de lait à vendre au village, en passant sur une longue et large planche dont elle avait toujours peur de tomber, mais heureusement, ça n’est jamais arrivé. Ensuite, elle remontait à la ferme, elle écrémait le reste du lait, puis elle barattait le beurre à la main. L’hiver, ça allait, mais l’été, c’était compliqué parce qu’il faisait trop chaud. Il fallait donc remonter de l’eau fraîche de la rivière pour le refroidir et l’empêcher de fondre. Tous les trois jours, elle descendait avec le beurre en plus du lait pour le vendre à l’épicerie du village. Toujours en passant par dessus la rivière qui lui faisait si peur. D’ailleurs, plus tard, la rivière lui a provoqué la pire peur de sa vie, lors de la pire journée de sa vie. Elle avait couché sa fille alors à peine âgée de deux ans pour la sieste, mais quand elle est allée dans la chambre pour réveiller la petite, elle n’était plus dans son lit. Son mari et elle ont donc arpenté la rivière en tout sens, et après plusieurs heures, ils ont fini par se dire que l’enfant avait été emportée par les flots. Mais c’est à ce moment là que quelqu’un est venu les chercher : la petite fille était en train de pleurer sur la place du village. Elle s’était levée de sa sieste et avait suivi le chien jusque là. De cette journée, Yvette en fait encore des cauchemars.
Yvette est veuve depuis ses 70 ans. Un an après la mort de son mari, elle a réalisé qu’elle n’était jamais allée nulle part, sauf à Jersey où elle avait travaillé deux étés. « Avec des Anglais. Je ne comprenais rien à l’anglais et moi je ne parlais que breton. Alors forcément, on ne se comprenait pas, mais on rigolait bien quand même ». A 71 ans, Yvette a donc décidé de voyager. Elle est d’abord allée passer une semaine à Paris. Même qu’elle est montée sur la tour Eiffel. Et puis, elle est allée voir le château de Versailles. C’est très grand, et elle aurait bien aimé passer plus de temps dans les jardins. L’année d’après, elle est allée dans les Alpes. Puis dans les Pays Basques. Puis deux fois en Alsace parce que c’est très joli et qu’on y mange rudement bien. Maintenant, elle voyage un peu moins, parce que c’est quand même un peu fatigant de sauter d’un train à l’autre. Mais elle aimerait bien aller en Italie, il paraît qu’on y mange très bien.
Yvette est très entourée par sa famille, en fait le hameau héberge ses filles, fils, petits-enfants et quelques neveux. Sauf une maison où vit entre autre un adolescent qui apprend le breton à l’école. Alors deux fois par semaine, ce jeune homme rend visite à Yvette pour travailler son accent « celui qu’on leur apprend à l’école ne ressemble à rien » en mangeant des crêpes.
J’aurais aimé rester plus longtemps, non seulement parce qu’Yvette était incroyablement gentille, que ses crêpes étaient délicieuses, mais aussi parce qu’elle a une excellente mémoire d’une époque disparue. Malheureusement, mon travail ne consiste qu’à poser des questions à base d’hectares, de tracteurs, de labour et de gestion des déchets. Alors que, vous en conviendrez, chez Yvette, ça n’était vraiment pas le plus intéressant.
* Je sais bien que tout le monde, maintenant, voudrait aller manger des crêpes chez Yvette, mais évidemment, Yvette ne s’appelle pas vraiment Yvette. Je n’arrive pas à m’en tenir strictement au devoir de réserve, alors je triche un peu en anonymisant.