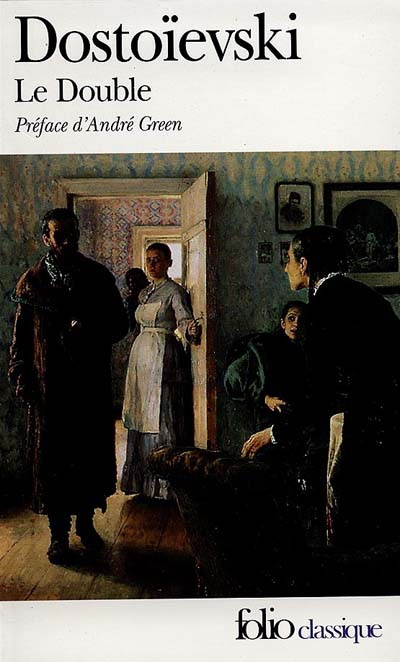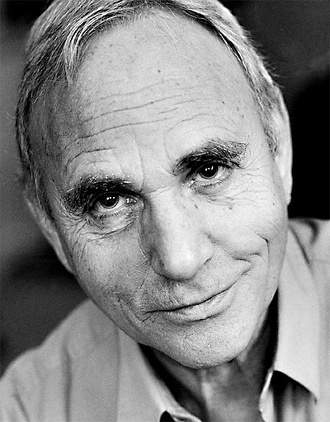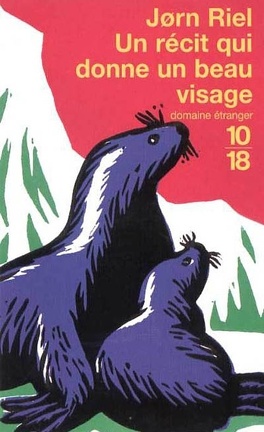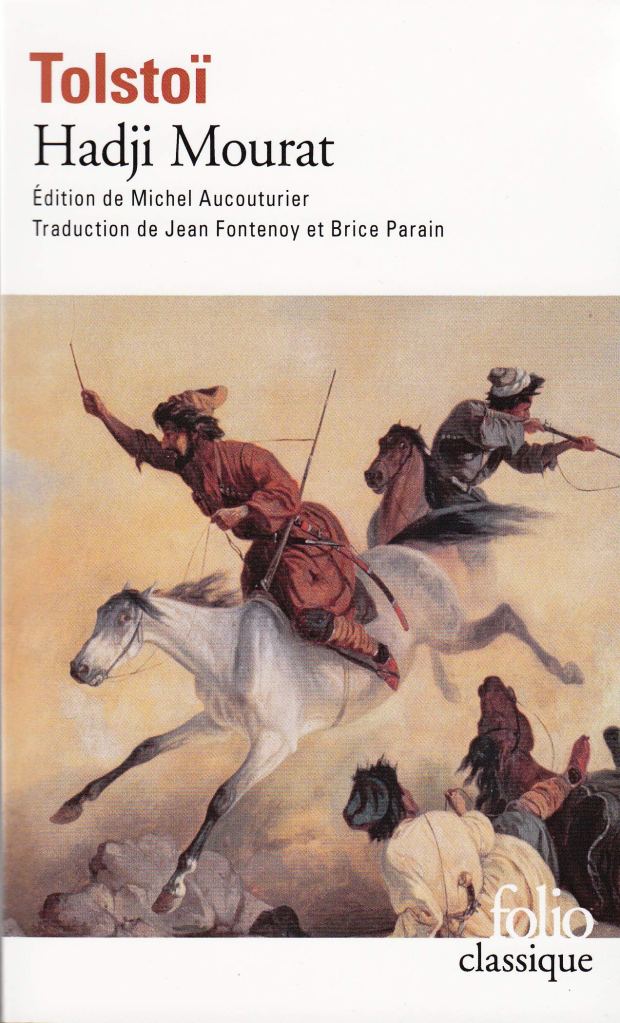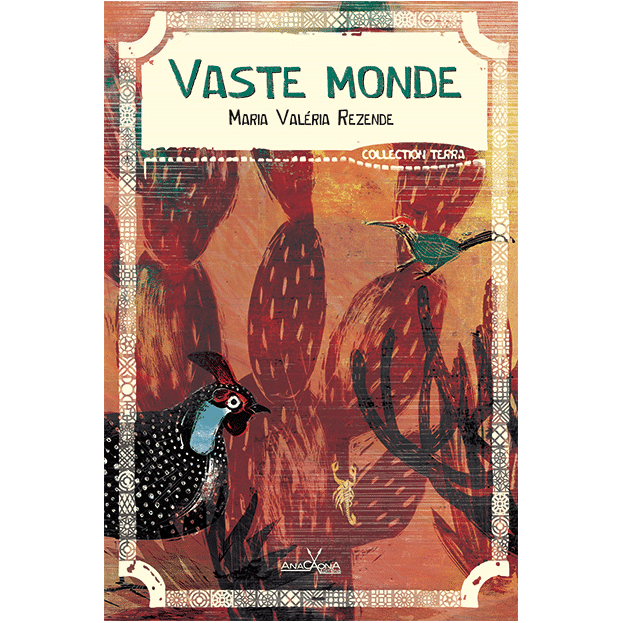Si on m’avait dit « tu devrais lire des romans maritimes », j’aurais commencé par répondre « ah bon, ça existe ? » et j’aurais probablement ajouté « mwé bof, je sais pas, c’est pas mon truc la mer ». J’aurais donc dit deux bêtises de suite. Parce que oui, le roman maritime est un genre à part entière, et n’en déplaise aux bourgeois de la culture, la littérature de genre n’est pas de la sous-littérature, d’ailleurs Hugo lui même s’y est essayé, ensuite, c’est tellement pas mon truc que je viens de m’enfiler trois romans maritimes de suite. Bon, je triche un peu, c’est surtout qu’on m’a mis dans les mains un recueil des œuvres maritimes d’Eugène Sue – environ un kilo et demi – l’importateur du genre en français, et que je n’arrive plus à m’arrêter.
L’avantage avec Eugène Sue, c’est qu’il a suffisamment été marin lui-même pour ne pas raconter n’importe quoi. Et ce qui rend encore plus intéressant ses écrits, c’est que sa détestation des puissants et des bourgeois alliée à son humour sarcastique rendent l’ensemble fascinant au-delà des seules questions maritimes.
La Salamandre est donc un roman maritime publié en 1832 dans lequel Eugène Sue va dresser un portrait aussi précis que vivant de la marine de guerre et en profiter pour se moquer allègrement de la Restauration et du retour des nobles inutiles qu’elle a engendré. La Salamandre est le nom de la frégate dont on va suivre l’équipage, tous durs et braves marins bretons, sauf un qu’on nommera donc Parisien. On va beaucoup parler de la hiérarchie et de la discipline absolument indispensables pour que tout le monde rentre vivant au port, des beuveries à terre – et quelle beuverie épique va-t-il nous décrire ! – de l’abnégation des officiers les plus compétents. Sauf que voilà : à la Restauration, les nobles qui avaient fui le pays reviennent en France, et certains seront promus essentiellement par népotisme et en dehors de toute considération pour leurs compétences – ou leur absence de compétence. C’est ainsi que la pauvre Salamandre va se retrouver affublée d’un marquis pour commandant, absolument incapable de tout. Le roman aurait d’ailleurs pu être sous-titré « le triomphe de la stupidité ».
Évidemment, je pourrais vous raconter l’histoire, mais comme j’essaie de vous convaincre de découvrir cette œuvre riche et palpitante, je n’en dirai rien de plus, si ce n’est qu’il ne faut pas se laisser décourager par les premières pages : si Sue est un excellent auteur, ses introductions ne sont pas à la hauteur de ses conclusions. Mais La Salamandre tient autant du pamphlet que du roman maritime et ses conclusions n’ont absolument rien de démodé, ce qui est triste pour nous mais permet au moins de rendre l’œuvre intemporelle. Elle contient absolument tout ce qu’on peut attendre d’un roman : du fond, de la forme, de l’humour, de la colère, de l’aventure, de la réflexion. C’est vraiment trépidant, on le dévore et on arrive au bout un peu essoufflé par tant d’aventures.
La Salamandre ferait vraiment un film incroyable, mais comme personne ne le fera, il ne reste qu’à le lire.