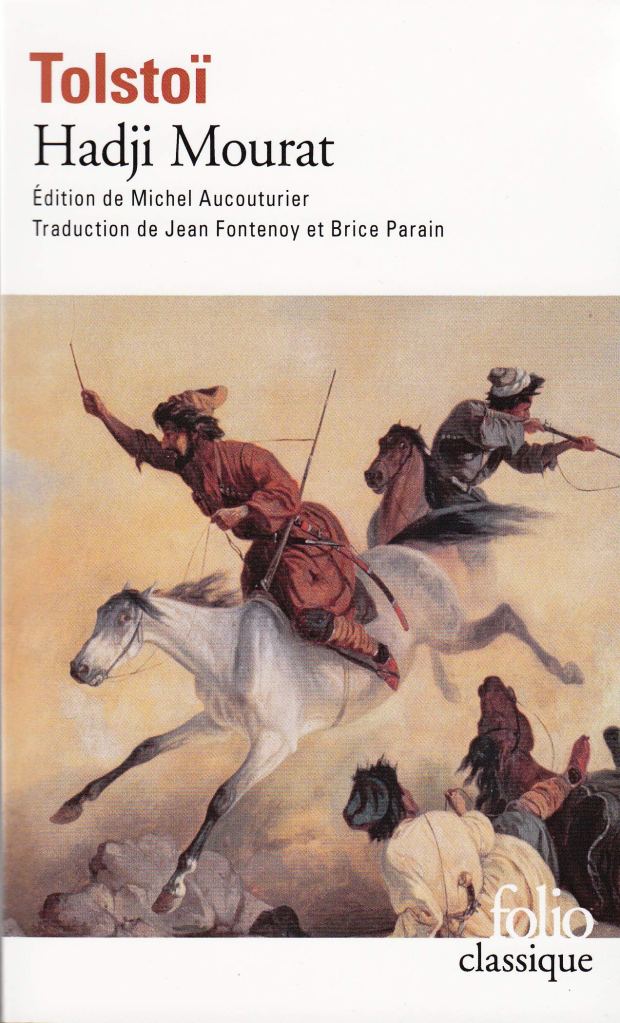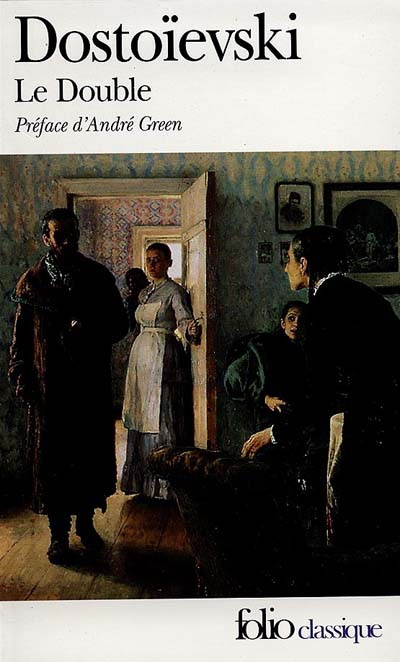
Sur l’échelle d’épaisseur des romans russes, Le Double de Dostoïevski est une nouvelle : un peu plus de deux cents pages, ça fait moins peur. Mais en matière de littérature, on ne peut pas se fier à l’épaisseur pour déterminer la difficulté d’accès : personnellement, et pour rester chez Dostoïevski, j’ai trouvé Crime et Châtiment beaucoup plus simple à lire.
Mais ça n’est pas parce que c’est plus ardu d’accès que c’est moins bon : il faut juste un peu de temps pour entrer dans le texte. Et ce parce qu’ici, entrer dans le texte signifie entrer dans la tête du personnage principal qui est en train de la perdre, justement, sa tête. Et n’allez pas croire que je vous divulgue méchamment l’intrigue pour vous gâcher le plaisir : c’est Dostoïevski lui-même qui le fait. A l’opposé des modes de narration actuelles avec plein de suspens, lui annonce toujours le contenu de ses romans dès le titre : il y a un crime suivi d’un châtiment, ou, ici, il y a un gars qui croise son double et si on n’est pas dans un roman de science-fiction, et ça n’est pas le créneau de Dostoïevski, c’est que la santé mentale du personnage n’est pas au top de sa forme. Si son compatriote Tolstoï est le maître des fresques politico-sociales, Fiodor, lui, est celui des tréfonds de la psychologie des individus. Donc voilà : on sait tout de suite que le personnage est en train de partir en cacahuète, quelque part entre le délire de persécution et les bouffées de toute-puissance, on se doute bien que ça va mal se terminer, et tout l’intérêt de la lecture sera de voir comment l’auteur va traiter ça, comment il va nous emmener loin dans les pensées d’un personnage abîmé, et comment il va nous montrer que la folie peut être en réalité un mécanisme qui relève de l’ultime pulsion de vie.
Tout le génie de Dostoïevski réside autant dans sa capacité à décrire la folie de l’intérieur que dans celle de nous faire suivre un personnage qui n’a par ailleurs pas grand-chose d’attachant. Fonctionnaire moyen en tout, lâche, désagréable voire parfois carrément méchant indépendamment de sa folie, on ne tremble pas à l’idée qu’il ne se relève pas. On assiste à sa chute de l’intérieur avec détachement, jusqu’à un certain point. Voilà ce qui fait tout l’aspect fascinant de Le Double.
D’habitude, j’évite de parler du contenu précis d’un roman, mais ici ça n’a vraiment aucune importance : l’histoire est en soi archétypale, l’intérêt profond réside absolument dans la manière dont elle est traitée par l’auteur. Il me semble que quiconque souhaiterait écrire un roman devrait commencer par décortiquer celui-ci pour savoir comment donner une substance psychologique riche à ses personnages.
Bref : n’ayez pas peur, lisez Dostoïevski.