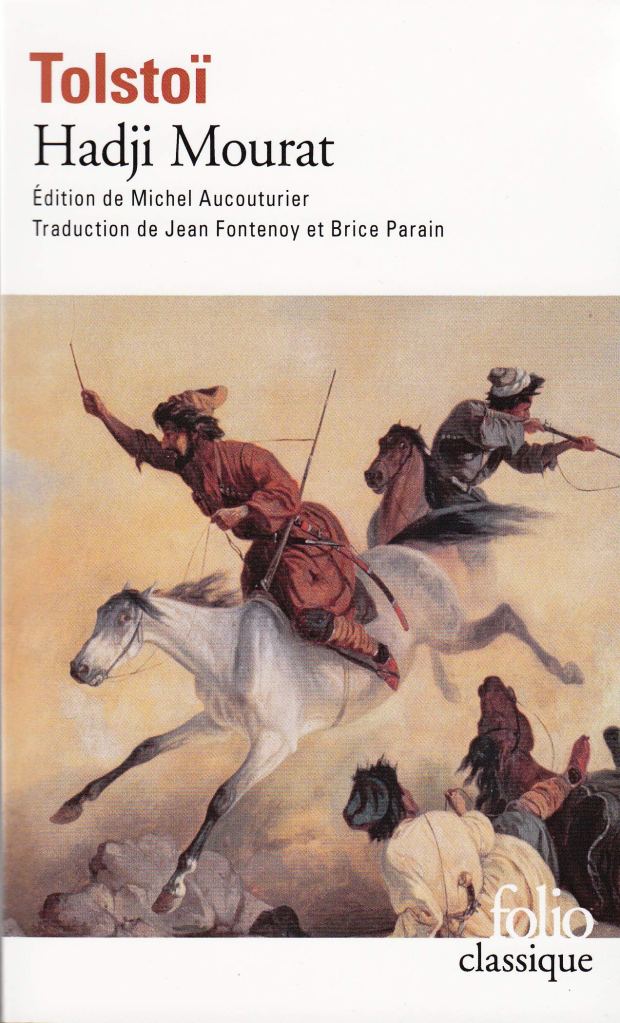
Hadji Mourat est le moins tolstoïen des romans de Tolstoï à plusieurs titres. Pour commencer, il est court, moins de deux cents pages si on enlève la préface – ne lisez jamais les préfaces, en particulier celles des romans de Tolstoï, avant d’avoir terminé l’ouvrage, l’essentiel relève de la mauvaise paraphrase de l’œuvre, du spoiler – les notes et les cartes. Ensuite, il n’y a aucune considération sur l’agriculture, et à peine plus sur la foi, les deux obsessions de Tolstoï. Enfin, il ne se déroule presque rien ni à Pétersbourg ni à Moscou : tout se passe dans le Caucase.
Mais ça n’en est pas moins passionnant à découvrir, d’autant que Hadji Mourat est un personnage historique. Il était le chef des Avars, l’un des peuples de l’actuel Daghestan, région voisine et tout aussi musulmane de la Tchétchénie. Au début du XIXe siècle, sous les prétextes fallacieux habituels des colonisateurs – en substance, « on va aller civiliser ces sauvages montagnards même pas chrétiens, c’est dire s’ils sont barbares – la Russie voulait « pacifier » le Caucase où personne n’avait rien demandé. Jeune soldat, Tolstoï avait participé à cette guerre et, vieillissant, il a souhaité écrire l’histoire tragique de Hadji Mourat. Si on transposait l’histoire chez nous, c’est comme si Hugo avait écrit un roman sur l’histoire de l’émir Abdelkader.

C’est passionnant à lire car de ce côté-ci du monde, on ne connaît pas bien, voire pas du tout, l’histoire du Caucase. Cette guerre de colonisation a pourtant duré presque cinquante ans, et à y regarder de près, ça donne quelques clefs pour comprendre le bazar actuel en Tchétchénie et au Daghestan. Pacifiste convaincu, Tolstoï dézingue le tsar Nicolas 1er, piètre tacticien prêt à raser des forêts entières pour ôter toute possibilité de planque aux Caucasiens, et écrit quelques unes des plus belles pages anticolonialistes de la littérature, ne passant pas sous silence les exactions russes, meurtres d’enfants, femmes violées, récoltes brûlées, arbres fruitiers abattus, puits souillés… Le chapitre XVII, en particulier, tient en deux pages et vaut pamphlet. Juste un court extrait :
« Les anciens s’étaient rassemblés sur la place et, accroupi à la musulmane, ils discutaient de la situation. Nul de parlait de haine pour les Russes. Ce que tous les Tchétchènes, petits et grands, ressentaient, était plus fort que la haine. Tout simplement, ils ne reconnaissaient plus ces chiens de Russes pour des hommes, ils éprouvaient tant de dégoût, de répulsion, d’horreur devant la stupide cruauté de ces êtres que leur désir de les exterminer, comme celui d’exterminer les rats, les araignées venimeuses, les loups, était un sentiment aussi naturel que l’instinct de conservation.
Les habitants avaient le choix : ne pas abandonner leur village et rétablir au prix de terribles efforts ce qui leur avait coûté tant de peine à installer et qui avait été détruit si facilement, si stupidement en s’attendant à chaque minute à une nouvelle dévastation ; ou bien, contrairement aux préceptes de leur religion, et en dépit de leur sentiment de répulsion et de mépris pour les Russes, faire leur soumission. Les anciens prièrent, se décidèrent à l’unanimité (…) et l’on se mit tout de suite à la reconstruction. »
Si les gros romans de Tolstoï vous effraient, Hadji Mourat est une bonne porte d’entrée pour découvrir le style et la philosophie de l’auteur en peu de pages. Entre roman d’aventure, pamphlet politique et descriptions ethnographiques, il est riche de contenus sans jamais être assommant.










