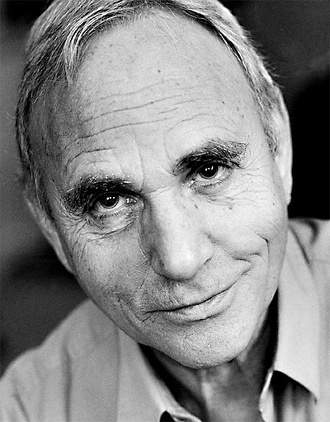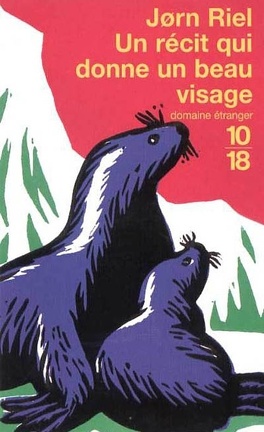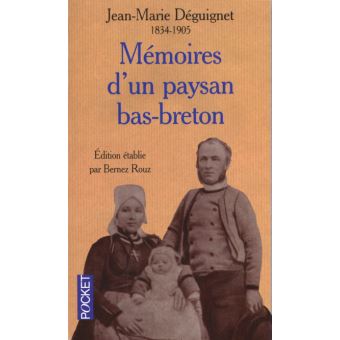On m’a offert cette BD qui parle des femmes en agriculture et j’étais super-contente parce qu’il y a peu de BD qui parlent de l’agriculture, et encore moins des femmes du milieu. Et puis je l’ai lue et j’étais tout de suite vachement moins contente.
En réalité, c’est surtout une BD qui parle des hommes qui sont dans leur intégralité des salauds dont l’unique but sur terre est d’empêcher les femmes d’exister et d’apprendre. Et j’insiste autant que la BD : l’intégralité. Tous les personnages masculins sont d’horribles machos qui ne comprennent rien à rien, qui retirent les outils des mains des femmes pour qu’elles n’apprennent pas à s’en servir, qui ne se réservent que les tâches supposées valorisantes, qui n’interviennent jamais sur les mises bas parce que « c’est un travail de femme », qui ne savent pas débarrasser une table, qui ne s’occupent jamais des enfants et qui font sans arrêt d’insupportables remarques sexistes. Tous. Et la seule solution, d’après cette BD, c’est de faire sécession et de ne plus travailler qu’en non-mixité.
Des boulots, j’en ai fait plein, de plusieurs sortes. En bureau, dans le social, dans la grande distribution, liste non-exhaustive, et partout, j’ai dû me bagarrer en tant que femme. C’est sans doute d’ailleurs ce qui a participé à ce que je ne trouve jamais tout à fait ma place dans ces milieux. Et puis j’ai atterri en élevage. Et c’est là que je suis restée le plus longtemps, parce que j’adorais ça et aussi parce qu’enfin j’ai pu cesser de me bagarrer. Certes, à l’occasion, j’ai pu voir des individus archaïques qui faisaient des remarques déplaisantes. Je les rembarrais et on ne les y reprenait plus. D’autant qu’en général les patrons en rajoutaient une couche : un bon patron n’aime pas qu’on fasse chier sa salariée et quasi tous les éleveurs pour qui j’ai bossé auraient été horrifiés qu’on dise d’eux qu’ils étaient de mauvais patrons. C’était une question d’honneur pour eux. Dans l’ensemble, j’ai surtout eu des patrons mâles qui m’ont collé dans les mains des outils dont je ne savais absolument pas me servir et qui insistaient : tant pis si je faisais des conneries, c’est comme ça qu’on apprend. Et avec mes deux mains gauches, des conneries, j’en ai fait. Plein. Et le lendemain on me recollait le même outil dans les mains. En se moquant un peu, mais pas parce que je suis une femme, juste parce que je faisais des conneries. J’ai vu des grands-pères apprendre à leurs petites-filles à labourer, je vois encore un paquet de pères aller chercher les mômes à l’école, quitte à y aller en tracteur, et des maris débarrasser la table après le casse-croûte. Quant aux vêlages sur lesquels il fallait intervenir, c’était souvent les hommes qui le faisaient. La BD ne parle que d’éleveurs et éleveuses de chèvres et de moutons, l’écart peut venir de là sur ce point : c’est une réalité, les bovins sont de bien plus grosses bestioles, et s’il faut intervenir vite, si on n’a pas le temps d’aller chercher la vêleuse (un outil qui aide à démultiplier la force) alors oui, effectivement, j’ai beau être costaude, je n’avais pas forcément assez de force, pas plus que mes patronnes, et mieux valait qu’un mâle plus balaise s’en charge.
Je pourrais lister sur des pages les exemples d’une féminisation de l’élevage qui avance bien. Les vétérinaires rurales ici sont toutes des femmes. Je n’ai jamais entendu personne s’en plaindre. J’ai bossé pour un groupement d’employeurs agricole dirigé par une femme qui a imposé par statut la parité dans le conseil d’administration. Jamais entendu de récrimination à ce sujet. Récemment, j’ai vu un agriculteur qui a poussé la presse locale à faire un article sur une (très) jeune femme mécanicienne agricole parce qu’il trouvait ça important de montrer que ça change. Salaud.
Alors oui, en effet, les agriculteurs du coin ont une tendance marquée au paternalisme. C’est même pour ça qu’ils aiment bien nous apprendre à nous servir de ceci ou cela. Sauf qu’ils font exactement la même chose avec leurs jeunes salariés masculins. Le plus macho des patrons que j’ai eu s’est pavané le jour où il a dû se faire remplacer suite à une opération : il était fier de dire partout qu’il avait laissé son exploitation entre les mains d’une jeune femme. Si sa réaction est quelque peu discutable, on voit qu’au fond il avait bien compris qu’il était temps de laisser la place aux femmes.
Je ne doute pas une seconde qu’il y ait des femmes en agriculture qui ont pu en chier plus que moi : il y a des abrutis partout, c’est même sans doute la seule chose bien répartie sur la planète. Il est très possible qu’une femme qui souhaite s’installer seule se confronte à des vieux relents sexistes moisis. Ça n’a rien de spécifique à l’agriculture, j’ai vu la même chose dans des formations organisées par une Chambre des Métiers. Que les choses n’avancent pas assez vite, c’est un fait, mais ça n’a absolument rien à voir avec le monde agricole spécifiquement. Que tous les hommes soient des salauds incapables de réfléchir à ces questions, non. Juste non. Ou alors, c’est que j’ai passé ces dix dernières années sur une autre planète. Et certes la Bretagne a ses spécificités, mais je ne crois pas qu’elle soit particulièrement plus progressiste que la moyenne, et jusqu’à preuve du contraire, elle est bien sur terre.
Pour conclure, si vous voulez dégoûter à jamais les femmes de l’agriculture, offrez-leur cette BD. Comme ça c’est sûr, ça restera un milieu d’hommes. Mais si vous êtes une femme qui veut se lancer dans le milieu : juste, allez-y. Rembarrez et fuyez les cons là comme ailleurs et rassurez-vous : des alliés, vous y en trouverez de tous les genres.